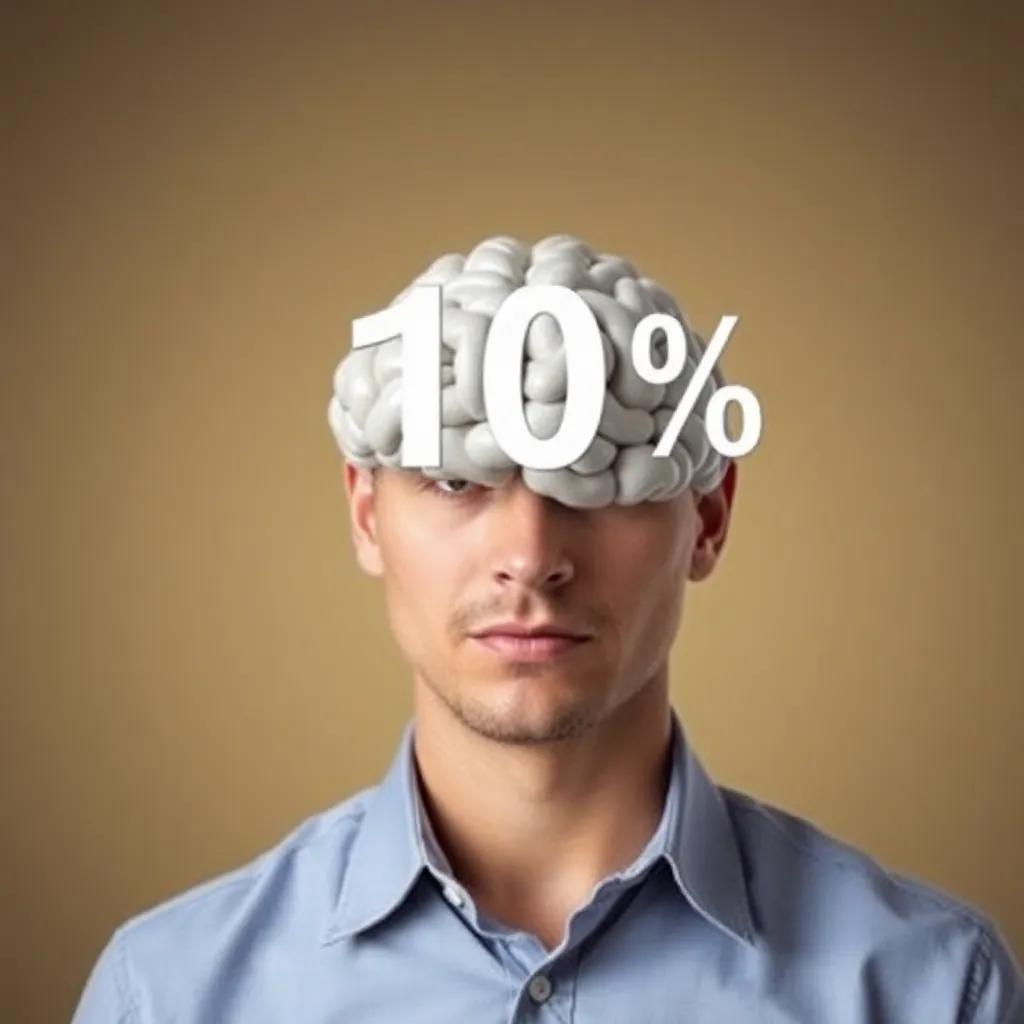Depuis des décennies, une idée reçue tenace circule sur notre potentiel cérébral. On nous dit que nous n’utiliserions que 10% de la capacité de notre cerveau, sous-entendant que les 90% restants constituent une immense réserve inexploitée. Si on arrivait à accéder à la totalité de nos ressources intellectuelles, nos facultés mentales seraient décuplées ! C’est du moins ce que suggère cette croyance populaire alimentée par les films de science-fiction et autres œuvres fantasques.
Imaginez si c’était vrai… Avec un tel potentiel disponible, nous deviendrions des êtres surpuissants, dotés de facultés intellectuelles hors du commun. Nous pourrions apprendre des langues en un clin d’œil, résoudre des équations complexes instantanément ou devenir de véritables encyclopédies vivantes. Nos pouvoirs mentaux seraient démultipliés et défieraient l’entendement.
Malheureusement, je vais devoir dissiper ce beau rêve dès à présent. Cette mystérieuse réserve de capacités inexploitées n’est rien d’autre qu’un mythe tenace, une des plus anciennes « fake news » scientifiques. En réalité, nous exploitons l’intégralité des ressources cérébrales dont nous disposons. Bien que séduisante, l’idée que nos capacités mentales puissent être exponentiellement augmentées ne repose sur aucun fondement scientifique valable. Pire, elle va à l’encontre de tout ce que nous savons du fonctionnement et de l’évolution du cerveau humain. Pour mieux comprendre les raisons de ce mythe et en révéler le caractère erroné, j’ai pour vous un long voyage au cœur de nos cerveaux.
Au commencement était le neuromythe
Cette légende urbaine des 10% de notre cerveau fait partie de ce que l’on appelle les « neuromythes ». Un neuromythe est une idée fausse, parfois même une pure invention, se rapportant au fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Ces mythes fleurissent la plupart du temps par une mauvaise interprétation des recherches scientifiques légitimes, voire une déformation délibérée à des fins commerciales ou idéologiques.
Loin d’être de simples lubies inoffensives, les neuromythes peuvent avoir des conséquences préjudiciables. Ils contribuent à entretenir une forme d’illettrisme scientifique sur le rôle et le fonctionnement du système nerveux. Dans le pire des cas, certains mythes idiots nourrissent des dérives commerciales malsaines vendant des produits ou services censés « améliorer » les performances intellectuelles.
Le mythe des 10% figure parmi les plus tenaces. Certains spéculent que son origine remonterait à une remarque attribuée par erreur au célèbre psychologue William James, affirmant que l’être humain atteint rarement son plein potentiel. D’autres estiment qu’il découle d’une mauvaise interprétation des travaux du neurologue américain Karl Lashley qui aurait initialement constaté que seule une petite partie du cerveau semble impliquée dans certaines tâches spécifiques. Quelle qu’en soit la source initiale, ces propos ont ensuite été déformés et exagérés pour alimenter le mythe toujours vivace aujourd’hui.
Réfutation scientifique du mythe des 10%
Au-delà de ces spéculations sur son origine, il existe de solides arguments scientifiques pour réfuter définitivement cette idée selon laquelle nous sous-exploiterions massivement les capacités de notre cerveau. En voici les principaux :
Arguments évolutionnistes et anatomo-physiologiques
D’un point de vue évolutionniste, il serait pour le moins étrange que la nature ait conservé un organe ne fonctionnant qu’à 10% de ses capacités. Au cours de millions d’années d’évolution, les organes peu ou mal utilisés finissent par régresser lorsqu’ils ne présentent pas d’avantage sélectif pour l’espèce. Sachant que le cerveau humain est l’un des organes les plus énergivores – il ne représente que 2% de notre masse corporelle mais consomme près de 20% de nos ressources énergétiques au repos –, il est impensable qu’un tel gaspillage de ressources ait pu être conservé par l’évolution.
D’un point de vue anatomique et physiologique, le fonctionnement du cerveau humain a été largement cartographié, zone par zone. Il n’existe aucune région cérébrale qui soit systématiquement inactive, chaque partie contribuant au fonctionnement d’ensemble selon des modalités propres. Même les régions non-impliquées directement dans une tâche cognitive demeurent dans un état d’activité de base indispensable, et sont en tous cas loin d’être totalement éteintes.
Comme le souligne Catherine Del Negro, chercheuse CNRS en neurosciences : « Si toutes les zones du cerveau étaient stimulées en même temps, cela provoquerait une crise d’épilepsie totale ». Ce qui montre bien que, loin de rester inutilisées, les diverses régions cérébrales régulent finement leur niveau d’activité pour permettre un fonctionnement harmonieux.
Arguments tirés de l’observation clinique
L’observation clinique des patients présentant des lésions ou anomalies cérébrales fournit une autre preuve accablante contre le mythe des 10%. En effet, même une petite lésion localisée dans une région restreinte du cerveau peut engendrer des troubles moteurs, sensitifs ou cognitifs partiels mais très handicapants.
Comme le résume Christophe Rodo, doctorant en neurosciences à l’Université d’Aix-Marseille : « Des milliers d’études sur des personnes avec des lésions cérébrales ont démontré qu’aucune zone du cerveau n’était inutile ». S’il était vrai que nous n’utilisions qu’un dixième du potentiel cérébral, alors les dommages causés par de telles lésions ne devraient pas avoir un impact aussi massif sur les facultés du patient.
Preuves apportées par les techniques d’imagerie cérébrale
L’avènement des techniques d’imagerie cérébrale modernes constitue sans doute la réfutation la plus évidente du mythe des 10%. Grâce à l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), la tomographie par émission de positons (TEP) ou encore l’électroencéphalographie (EEG), il est aujourd’hui possible de visualiser en temps réel l’activité neuronale dans les différentes régions du cerveau.
Les chercheurs ont ainsi pu constater qu’en dehors même de toute tâche cognitive particulière, une activité de base diffuse persiste dans l’ensemble du cerveau. Il n’y a donc pas de région cérébrale inactive. Cette activité basale est d’ailleurs indispensable pour maintenir les fonctions vitales ainsi qu’un état de conscience minimal.
Lors de l’exécution d’une tâche spécifique, on observe bien une suractivation de certaines zones, mais jamais l’ensemble du cerveau ne devient complètement sombre comme ce serait le cas si 90% de ses régions restaient totalement inutilisées. En réalité, comme l’explique Joe Doux, professeur en neurosciences à l’Université de New York, « le cerveau pourrait être actif à 100% en réalisant une tâche même si seule une toute petite partie lui est entièrement dédiée ».
Les ressorts d’un mythe populaire
Malgré les preuves scientifiques accumulées, le mythe des 10% de notre cerveau reste une idée récurrente dans la culture populaire. Outre les origines historiques évoquées précédemment, on peut s’interroger sur les raisons d’un tel succès. Pourquoi ce mythe particulier séduit-il autant ?
Une des explications réside sans doute dans son caractère merveilleux et flatteur pour l’ego humain. L’idée de posséder d’immenses ressources intellectuelles inexploitées, une sorte de puissance cérébrale latente, ne peut que nourrir nos fantasmes d’omniscience et de toute-puissance. Dans cette optique, le mythe des 10% conforte une vision de l’être humain comme une créature aux potentiels mentaux illimités.
Le mythe fait aussi miroiter la promesse d’une amélioration spectaculaire de nos capacités actuelles. Cette idée qu’il suffirait de « dérider » une partie de notre cerveau pour devenir plus intelligent, plus performant, plus doué séduit par sa simplicité apparente. Elle laisse entrevoir la possibilité d’un accomplissement instantané par une méthode quasi-miraculeuse mais sans aucun effort réel.
Dans une société où l’intelligence, la performance et la réussite sont érigées en absolus, l’appât d’un raccourci, d’un remède miracle pour accéder au sommet est particulièrement tentant. Comme le souligne une étude de l’Université de Montréal, « cette idée reçue persiste sans doute parce qu’elle nourrit l’espoir, légitime et probablement fondé, que nous pouvons nous améliorer ».
Enfin, le mythe profite aussi du regain d’intérêt pour les neurosciences ces dernières années, ainsi que de sa reprise dans des œuvres de fiction grand public. Il suffit qu’il soit habilement distillé dans un film à gros budget pour gagner en crédibilité auprès du grand public déjà prompt à accueillir ce genre d’élucubrations.
Révélations sur les capacités insoupçonnées de notre cerveau
Si nous utilisons bel et bien la pleine capacité de nos ressources cérébrales, cela ne signifie pas pour autant que notre potentiel intellectuel soit gravé dans le marbre une fois pour toutes. En réalité, notre cerveau dispose d’une plasticité remarquable et de facultés d’adaptation stupéfiantes. Loin d’être un outil rigide aux capacités immuables, il est capable de se remodeler et de s’améliorer considérablement tout au long de notre existence.
Cette propriété connue sous le nom de neuroplasticité repose sur la formidable malléabilité des connexions qui relient les quelques 100 milliards de neurones constituant notre encéphale. En réponse aux diverses sollicitations de l’environnement, de nouvelles connexions se créent sans cesse pendant que d’autres se renforcent ou disparaissent. En fonction de nos activités, de nos apprentissages et de notre mode de vie, la configuration de notre « câblage » neuronal se remodèle en permanence.
C’est ce qui explique que nous puissions acquérir tout au long de notre vie de nouvelles connaissances, de nouveaux savoir-faire ou encore développer de nouvelles aptitudes intellectuelles jusqu’alors insoupçonnées. À l’inverse, certaines capacités régressent au fil du temps si elles ne sont plus sollicitées régulièrement.
Prenons quelques exemples pour mieux illustrer les facultés d’adaptation de ce fascinant organe qu’est notre cerveau :
Apprentissage d’une nouvelle langue
Bien que chacun ait une prédisposition et des facilités propres, l’apprentissage d’une nouvelle langue reste possible quel que soit notre âge. Les recherches ont montré qu’une immersion dans une langue jusqu’alors inconnue sollicite massivement certaines régions du cerveau habituellement peu mobilisées pour la langue maternelle.
Des réseaux neuronaux entièrement nouveaux doivent alors se mettre en place pour traiter ce nouveau système linguistique. Une fois ces réseaux établis, le locuteur acquiert une compétence nouvelle qui, au début peut sembler laborieuse, mais qui finit par devenir aussi aisée que le maniement de sa langue natale. Cette adaptation est facilitée chez les enfants mais reste tout à fait possible chez l’adulte, avec certes un peu plus d’efforts.
Pratique d’un instrument de musique
Démonstration flagrante des capacités d’adaptation du cerveau, la pratique musicale régulière entraîne une réorganisation majeure des réseaux neuronaux associés aux fonctions sensori-motrices, attentionnelles et mnésiques. Ainsi, les études par imagerie cérébrale ont montré que le cerveau des musiciens professionnels présente des différences anatomiques et fonctionnelles marquées par rapport aux non-musiciens.
Ces différences sont d’autant plus importantes que l’apprentissage de la musique a commencé à un âge précoce. La pratique intensive et régulière d’un instrument dès l’enfance modèle littéralement certaines régions du cerveau comme le cortex auditif, les régions frontales liées à la planification motrice et les aires associatives multimodales. En quelque sorte, le continuel remaniement des connexions synaptiques à l’œuvre pendant ces années décisives sculpte la matière cérébrale elle-même pour optimiser la pratique musicale.
Activités d’une personne malvoyante
Un autre exemple saisissant des potentiels insoupçonnés de notre cerveau est fourni par les personnes devenues malvoyantes très tôt dans leur existence. En l’absence de sollicitation des aires visuelles, une plasticité intermodale extraordinaire se met en place pour redéployer ces régions normalement dédiées à la vision à d’autres fonctions comme l’audition ou les perceptions tactiles et spatiales.
Ce phénomène explique les performances stupéfiantes de certains aveugles capables de se déplacer avec une aisance déconcertante grâce à une forme d’écholocalisation, ou encore de lire le relief des objets avec une sensibilité exacerbée au toucher. Toutes ces prouesses reposent sur la remarquable capacité des aires visuelles de ces personnes à se réaffecter à de nouvelles opérations de traitement sensoriel.
Ces exemples, parmi tant d’autres possibles, illustrent à quel point le cerveau est capable d’exploiter ses ressources de manière optimale selon les nécessités du moment. Bien que les régions constitutives de notre encéphale soient initialement spécialisées, les protections associatives font sans cesse migrer ces régions d’une fonction à l’autre;